
Navigateurs Aériens et DENAE
de l'Aéronautique Navale

 |
Navigateurs Aériens et DENAEde l'Aéronautique Navale |
 |
(1928-2020)
CHAPITRE 9
Le petit prof...
Vers la fin de l'année 1963, j'apprends par des bruits de couloir qu'un instructeur est recherché chez nous par l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile pour faire effectuer quelques heures d'exercices de navigation ainsi que des séances d'interrogations aux élèves. C'est très tentant, pour moi qui commence à ressentir le besoin de quelque chose de nouveau qui me sorte de ma routine. D'autre part, c'est tout à fait à la portée d'un débutant comme moi, dont les premiers essais de cours datent du temps de Khouribga, en 1951. Je dois un peu me battre avec le chef navigateur, qui ne m’aime pas trop, et qui me préférerait un collègue moins ancien. Pour une fois que l'ancienneté me profite, je ne laisse pas ma place ! Je commence donc une carrière - c’est un bien grand mot pour quelques heures d'interrogations - de professeur, tout en continuant à voler au même rythme. Pendant l’année scolaire 1963-1964, je me borne donc à proposer, une fois par semaine, de petits exercices de navigation pratiques aux élèves de l'ENAC. J'ai hérité de la part de mes prédécesseurs de questions du plus grand classicisme. Rapidement, j'introduis quelques « énigmes » de mon cru, ce qui, par voie de conséquence, m'oblige à me replonger dans mes cours vieux de seize ans ! Car je mesure tout ce que j'ai oublié à l'aune de ce que je veux apprendre aux jeunes futurs collègues que je vois chaque semaine. Et puis, les choses ayant bien évolué depuis mon examen, il me faut non moins rapidement, mettre mes connaissances à jour en utilisant de la documentation récente... ce cycle infernal durera tant que je ferai de l’instruction, c'est-à-dire jusqu’à ma retraite. Ces interrogations à l’ENAC constituent donc pour moi une excellente mise en train pour aller plus loin dans cette direction. Car c'est bien ce qu'il faut que j'envisage. Cinq ans auparavant, sur les instances de certains d'entre nous, navigateurs, la Compagnie nous a fait passer les tests d'aptitude au pilotage de l'Armée de l'Air. J'en suis ressorti avec le maximum ! Ce qui peut prouver : 1/ ces tests sont une aimable plaisanterie ou 2/ le commandant de l'escadrille - école de Khouribga avait tout faux ! L'avenir n'a pas tranché, navigateur je suis, navigateur je resterai jusqu'au bout, tel sera mon destin. Et je ne m’en plains pas, car si je suis une sorte de dinosaure, parmi les derniers représentants d'une profession qui eut ses gloires et ses héros, profession en général méconnue de l'homme de la rue, d'ailleurs, j’en ai tiré de grandes satisfactions. Et, à l'heure où je me retournerai pour regarder le chemin parcouru, je pourrai me dire que je n’ai pas à rougir de celui que j'ai suivi et dont je trouve, sans me hausser du col, le bilan assez flatteur. S'il faut attendre les autres pour recevoir des compliments, on risque d'attendre longtemps, mieux vaut s'en charger soi-même !
Cette petite crise d'autosatisfaction passée, j’en reviens aux études que m'impose mon nouvel état. Tout doucement, au début, on se met, sans même le réaliser, à potasser ses anciens cours, à rechercher de la documentation pour se remettre à jour. On se prend au jeu et on finit, par escalade, à tout voir sous l'angle de l'instruction professionnelle et à se demander si tel incident ne peut pas donner lieu à un problème ou à une question de cours. Cela amène alors à y regarder de plus près et à aller chercher dans les manuels si le problème a été traité et, si oui, comment. On voit là poindre le besoin d'écrire, un jour ou l'autre, un nouveau manuel qui, lui, apportera du neuf. J’y reviendrai I
Ma première année scolaire d'instructeur à l'ENAC terminée, le besoin se fait sentir d’un instructeur supplémentaire à Air France. Il s'agit d’enseigner la navigation à de futurs pilotes de la Compagnie. Ces jeunes gens viennent de l’Armée de l'Air, de l'Aéronavale, ou encore de l'ALAT, Aviation Légère de l'Armée de Terre. Ils ne possèdent pas le Brevet de Pilote de Ligne, aussi sont-ils mis en stage par Air France pour préparer et passer cet examen. D’autre part, la Compagnie prévoie qu'elle ne pourra pas utiliser pendant toute une carrière des navigateurs qu'elle recruterait en 1964, alors qu'elle à déjà des problèmes de cet ordre avec nous. Car elle a besoin de navigateurs avant de passer à l'automatisation qui montre le bout de son nez outre-Atlantique. On s'est dit en haut lieu qu'on peut utiliser les copilotes en fonction navigateurs en leur faisant passer le Brevet et la Licence de cette spécialité. Calcul qui se révélera excellent pour tout le monde. La Compagnie y a gagné des gens qui constitueront une réserve, un volant de fonctionnement où on puisera en période de pointe, les pilotes ont augmenté leurs connaissances aéronautiques, se préparant ainsi à leur futur rôle de commandant de bord. En retrouvant certains de mes élèves, des années plus tard, ils me diront tout ce que leur a apporté leur séjour parmi nous autres futurs dinosaures !
Outre mes cours aux stagiaires d’Air France, je continue mes séances d'interrogations aux élèves de l’ENAC. L'année scolaire 1964-1965 est, pour moi, une période de travail intellectuel intense, complètement différente des années précédentes. Une période de « remise à niveau » telle que je n’en ai pas connu depuis mes débuts. C'est, bien sûr, complètement différent des années précédentes où, certes, l'occupation ne me manquait pas mais se bornait, si l'on peut dire, à effectuer des courriers à haute dose ! Quand on est « navigateur 100% », suivant l’expression consacrée chez nous, sitôt l'avion arrivé à Orly, on peut rentrer chez soi, l'esprit léger, satisfait du travail fourni, dégagé de toute responsabilité jusqu'au prochain départ, deux ou trois jours après. Sauf situation d'exception, genre dépannage par exemple, pendant ce laps de temps, la tranquillité règne et je peux me livrer à un de mes vices, par exemple le modélisme. Du jour où je me retrouve instructeur, finis les petits bateaux et les petits avions. Je les retrouverai plus tard, beaucoup plus tard ! Pour l'heure, ils cèdent la place à l'étude du prochain cours ou à l'élaboration du test de la semaine suivante. Et il ne faut pas oublier que je suis toujours navigant, que, comme tel, j'ai des heures de vol à effectuer. Le nombre fixé par les accords Direction-Syndicat est moindre pour les instructeurs que pour les navigants « 100% » mais il faut arriver à caser les possibilités de courriers et les impératifs de cours dans le calendrier et ça n'est pas toujours facile ! Il m’arrive bien souvent de travailler en tant que « prof » toute la semaine et de partir en courrier le week-end. Ce serait mentir de dire que je m’en plains, mais je dois reconnaître que la vie de famille s’en ressent. Autre chose désagréable : l'instabilité de la situation. Pour des considérations bassement budgétaires, je suis nommé à mon poste d'instructeur quand le besoin s’en fait sentir impérieusement. Cela ne me facilite pas la vie et le Chef du Service Instruction, à qui cela aussi pose problème, se bat avec le Directeur des Opérations pour éviter d'avoir un instructeur « en pointillé » ! Je n'accéderai au statut d'instructeur permanent qu'au bout de quatre années et surtout parce que la charge d'instruction aura considérablement augmenté. Nous serons bientôt sept instructeurs, donnant des cours de formation pour les brevets de pilote de ligne, navigateur, pilote professionnel. Ayant été proposé comme examinateur à ce dernier examen, je laisse à un collègue les interrogations et exercices à l'ENAC. Nous avons à former comme navigateurs aériens des marins marchands que la Compagnie prend sous contrat pour quelques saisons, leur utilisation étant semblable à celle des copilotes. Mais le brevet n’étant pas tout, il est suivi d'un stage en vol sous l'égide d'un instructeur navigateur. Voilà un poste de plus qui s’ajoute à ma panoplie. Et je n'ai pas encore parlé des stages polaires à l'usage des anciens radios devenus navigateurs après la quasi-suppression de leur spécialité, qu'il faut lâcher sur la ligne polaire. Les pilotes suivent également ce stage avant leur premier courrier sur Anchorage. Je verrai même passer dans ma classe des équipages de Breguet Atlantic de la Marine Nationale, cet avion possédant l’équipement instrumental pour aller chasser le sous-marin sous les hautes latitudes. Le travail ne manque pas et il faut coordonner toutes les interventions des sept instructeurs et s'occuper activement du planning des cours. Personne n'est tenté de s'en charger, en dehors de moi, et le patron de l'école me propose de prendre cette fonction en charge. J'accepte, ne me rendant pas vraiment compte que j'accède alors à un autre niveau de responsabilité. Il y a beaucoup à faire car nous dépendons de plusieurs services et on n'a encore jamais eu à gérer tant d'instructeurs de navigation à la fois. Bien sûr cela va me valoir la jalousie de certains de mes collègues, surtout de la part de ceux qui ont refusé le job ! Car cela me vaut également une nomination, la première, celle de « Responsable du groupe de MM. Les Instructeurs navigateurs affectés au Centre d'instruction du PNT ». (Ouf ! ). Nous sommes en février 1968. Une grande mutation se prépare.
Evidemment, il y a le mois de mai, et pendant ce mois je ne volerai pas, comme beaucoup d'autres. A part ce manque d'activité, je ne vis rien de particulier quant à la Compagnie. Par contre, depuis quelques temps, on parle beaucoup de navigation par inertie et nous savons tous, nous, professionnels de la règle Cras, que l'avènement de cette nouvelle technique sera la mort définitive de notre profession. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est que ça arrive le plus tard possible. Ou bien que la Compagnie nous change de spécialité, par exemple en faisant de nous des copilotes, comme cela s'est déjà fait ailleurs. Air France ne recrute plus de navigateurs et complète ses effectifs, suivant les besoins actuels, avec les anciens radios, les copilotes , les marins marchands : elle ne veut pas s'encombrer avec des navigateurs dont elle ne saura que faire lors du remplacement des Boeing 707 par des Boeing 747. Elle aura bien assez à faire avec nous autres, titulaires depuis des années, dont il va falloir régler le sort. Car nous savons depuis quelques temps que, à l'aube des années 70, les 747 vont arriver, inéluctablement, et que leur instrumentation est basée sur trois plates formes à inertie, assurant en premier lieu la navigation, ou plutôt le guidage, excluant du même coup le navigateur de l'équipage. Cela explique et justifie les inquiétudes des plus jeunes de la corporation, dont je suis, ne voulant pas se laisser enfermer par les plus anciens dans une situation du style « wait and see ».
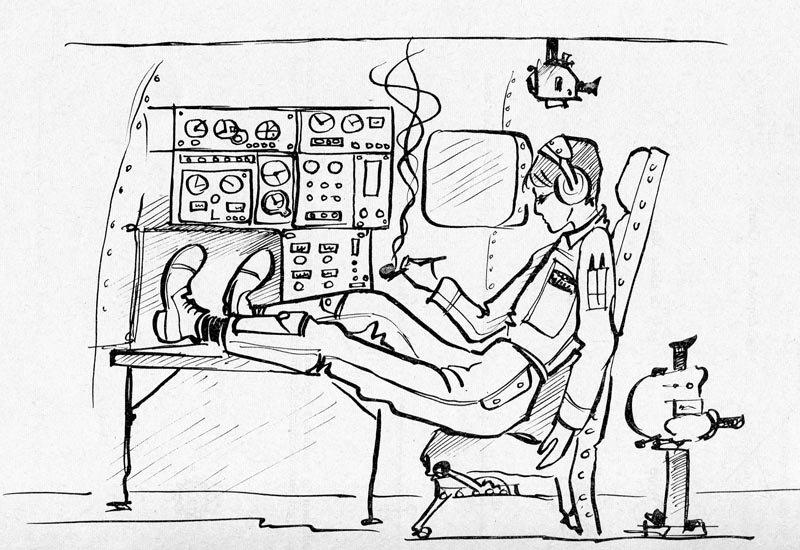
Nos avions sont maintenant pourvus de navigateurs à inertie !!!
Nous ne pensions pas, cependant, que ça allait arriver aussi vite. Car c'était compter sans la raison d'Etat. Que diable, direz-vous, que vient faire l'Etat là-dedans ? Suivez -moi bien : le Général de Gaulle veut sa force de frappe, avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et des avions Mirages IV. Il faut à ces vecteurs de la force atomique un système de navigation par inertie parfaitement indépendant de tout moyen extérieur. Depuis un bon moment, l'industrie française s'essaye à fabriquer des centrales à inertie dignes d’être installées sur les futurs fleurons de notre flotte, tant maritime qu’aérienne. Mais les essais ... ne sont pas transformés et le temps presse. Les Etats-Unis fabriquent bien des centrales à inertie qui fonctionnent, paraît-il, parfaitement, mais ils n'acceptent pas de les vendre car couvertes par le secret militaire. A moins que... A moins qu'on ne leur en achète suffisamment pour que la maison Litton, qui les fabrique, soit satisfaite du marché. On pourra alors autoriser ces chiens de Français à copier le cœur de la plate-forme, objet de tous leurs désirs. Germa alors l'idée, chez un ponte de la Compagnie ou du Ministère, on ne sait, de commander suffisamment de centrales Litton pour équiper les Boeing 707. Quant aux navigateurs qui œuvrent sur ces avions, eh bien... il n'y a qu'à les ficher dehors ! Cela a bien failli arriver et il a fallu une intervention énergique du Ministère des Transports pour obliger Air France à revoir sa copie et à s'entendre avec notre Syndicat. J’y reviendrai. Toute cette cuisine infâme se concocte derrière notre dos et je connaîtrai les dessous de l'affaire quand quelques semaines auront passé. Je devrai à un ingénieur extérieur à la Compagnie les révélations des turpitudes de cette marâtre. Je fais sa connaissance à l'occasion des cours que je suis amené à donner aux pilotes qui vont utiliser les plates-formes. Il y a bien des gens du Secteur Navigateur qui ont suivi des stages dans le but de dispenser ces cours. Ce sont des Anciens et, comme par hasard, ils ne sont pas disponibles quand on a besoin d'eux. Et moi, qui n'ai pas été jugé digne de suivre cet enseignement, je dois m'y coller au débotté quand arrive la première plate-forme et qu'il faut de toute urgence, et de préférence pour avant-hier, instruire un premier contingent de pilotes. Mon bon ami Pierre Courgeon et moi en sommes quittes pour apprendre « sur le tas » comment ça marche et ce qu’on peut en tirer.
Il est temps, je crois de parler un peu technique et d'aborder le problème des plates-formes à inertie dont je n'ai pas fini de vous entretenir. Quand un navigateur « fait de l'estime », il enregistre, en les traçant sur sa carte, les différentes directions suivies par l’avion (ou quelque mobile que ce soit d'ailleurs), en tenant compte du temps passé en suivant chacune d'elles, c'est-à-dire de la distance parcourue, fonction de la vitesse. Pour déterminer la direction, il dispose d'un compas, magnétique ou gyroscopique, qui lui donne le cap. Et il tient compte du vent, en corrigeant ce cap de la dérive pour obtenir la route suivie par rapport à la Terre. Le processus est complexe, car il fait appel à plusieurs instruments et il nécessite une grande attention pour obtenir une précision acceptable. De toutes manières, il est nécessaire de vérifier le résultat de ces tracés en observant la position par moyens radios ou astronomiques. Ce procédé de navigation classique nécessite donc la présence à bord d'un navigateur. Supprimer ce spécialiste est l'envie des Compagnies (Il faut les payer, ils tiennent de la place, ils peuvent faire grève...)
Et aussi de certains de nos camarades pilotes (« Moi, Chevalier du Ciel, j'ai horreur que quelqu'un me dise ce que je dois faire, c’est moi seul le patron à bord... »). Que l’on mette sur le marché un système qui permette de satisfaire les budgets et les ego ne peut que faire plaisir à tout le monde, ou presque !
Ce système, c'est la centrale à inertie. On dispose, grâce à des gyroscopes de très grande précision, d'une enceinte que l'on maintient horizontale et orientée par rapport au Nord géographique. C'est cet ensemble, le cœur du système, que l'on a surnommé « plate-forme ». Un calculateur, en fait un ordinateur, est associé au cœur, pour enregistrer les indications d’accéléromètres installés sur ladite plateforme. Tout déplacement est détecté par l'accélération qu'il génère. Celle-ci, donne la vitesse du déplacement, qui elle-même donne la distance parcourue. On fournit au calculateur la position de départ et à partir de là, tout déplacement va être comptabilisé. On obtient en permanence la position du mobile, dans notre cas, de l'avion. C'est de l'estime, et de haute précision. Un exemple : Pierre Courgeon et moi effectuons, en septembre 1968, un courrier de Paris à Los Angelès sans escale intermédiaire. Pas loin de douze heures de vol, et à l'arrivée, les deux plates-formes ont chacune une erreur inférieure à un mille nautique ! Nous nous regardons, Pierre et moi, avec tristesse : nous assistons à la mort de notre profession. Et en plus, il faut apprendre aux pilotes à se servir de ces boites noires (de ces bêtes noires ? ). C'est tout à fait le drame de celui qu'on va fusiller et qu'on oblige à creuser sa tombe !
Mais il faut régler le problème des navigateurs titulaires, dont certains ont encore des années d'activité devant eux. Il va falloir presque un an pour arriver à une solution. La première centrale à inertie arrive en août 1968, un accord est trouvé en juin 1969. Et encore, ça a fini par s’arranger parce que, comme je l'ai dit plus haut, le Secrétariat à l'Aviation Civile et Commerciale à refusé d'homologuer l'installation des plates-formes sur B707, donc la suppression du navigateur, tant qu'un accord ne serait pas trouvé. La négociation aboutit à une solution acceptable : La Compagnie gardait ses navigateurs jusqu'à l'âge moyen de départ à la retraite de l'ensemble des navigants. Il est, à ce moment de 53 ans. Jusque là, elle les utiliserait sur des avions non-équipés de plates-formes, dans toute la mesure du possible. Elle leur confierait des tâches d'instruction (style : creuser sa propre tombe, mais c'était toujours ça de pris !).
Je ne me classe pas parmi les passéistes ou pire les rétrogrades. Je comprends parfaitement l’évolution obligatoire de la technique et l'arrivée des B747 en tant qu'événement inéluctable. Où je ne suis pas d'accord, c'est qu'au nom de la raison d'Etat, on exécute une opération extrêmement coûteuse en équipant des avions déjà anciens avec des équipements modernes, en faisant payer la note à des gens comme nous en écourtant leur carrière. Enfin, pour ce qui est de mon cas, cela m'a amené à travailler des matières particulièrement intéressantes. Il me faut potasser la technique des centrales à inertie, à seule fin de l'apprendre aux pilotes : tous ceux de l'époque passeront me voir et pendant longtemps, après ma mise à la retraite, je rencontrerai dans les avions des gens qui me rappelleront qu'ils ont été mes élèves (à l'heure où j’écris ces lignes, c'est fini, ils sont eux-mêmes à la retraite et plus personne ne me connaît ! ).
En sus des cours, il y a les vols d'homologation des avions équipés de plates-formes. Ils se dérouleront jusqu’en juin 1969, c'est-à-dire, le hasard faisant bien les choses, qu’ils se termineront au moment de l’accord de fin de carrière des navigateurs. La Direction Générale de l'Aviation Civile exige que certains courriers transatlantiques soient effectués dans les conditions d'utilisation normale des systèmes à inertie, une navigation classique étant conduite parallèlement par un navigateur pour constater les écarts éventuels. La vérité oblige à dire qu’il n'y a pas beaucoup de dispersion autour de la route. Il y a bien quelques pannes, mais dont le nombre reste dans des limites statistiques acceptables, comme les écarts d'ailleurs. En juin 1969, cette expérimentation prend fin, la Compagnie Air France et le Syndicat tombent d’accord et signent la Convention fixant l'avenir des navigateurs. Les Boeing 707 peuvent traverser l'Atlantique avec un équipage à trois. Le navigateur est remplacé, sur les avions équipés, par deux boîtes noires de trente livres chacune, qui ne risquent pas d'élever la voix, ni dans les cockpits, ni dans les discussions syndicales. Certains pilotes émettant l'hypothèse que, peut-être, pour des raisons de sécurité, plutôt que trois, il vaudrait mieux être quatre dans un poste de pilotage conçu pour ce nombre on fait taire leurs inquiétudes avec une prime unique de mille francs ! Quel bel exemple de solidarité ! Après l'élimination des radios, ce sont les navigateurs qui sortent des cockpits. Il est facile de prévoir que, un jour, ce seront les mécaniciens qui feront les frais de la réduction de l'équipage à sa plus simple expression. On le verra sur Caravelle à la Finnair, sur DC9, sur Boeing 737, et, bien entendu, sur Airbus. Il n'y aura guère qu'en France que le départ des mécanos fera des vagues, oh, pas de bien grandes vagues ! Quant aux navigateurs, ils mourront à leur vie professionnelle sans déranger personne, bien proprement et bien poliment. Ceux qui tenteront de protester serons rapidement muselés par leurs anciens et se décourageront bien vite. Et personne n'en parlera plus. De profundis !
Il est également prévu, dans le texte de la Convention entre la Compagnie et le Syndicat, des transformations de navigateurs en pilotes. Elles avaient déjà commencé. En 1967, prévoyant le grand chambardement que l'arrivée des B747 allait amener, certains d'entre nous ont accepté d'être mis en stage de pilotage. J'ai trouvé pour ma part que ça revenait, après quinze ans de bons et loyaux services, à recommencer une carrière en étant payé à un tarif scandaleusement bas. Je n'en ai pas moins envisagé « d’y passer » et dans ce but, j'ai présenté le Brevet de Pilote de Ligne théorique en 1968, histoire d’être paré. Je l’ai obtenu sans trop de mal, bouchant les trous des manques dans certaines matières (ah ! le Droit Aérien ! ) avec mes notes en navigation et en technique avion. Des années de pratique, ça sert à quelque chose ! Ma moyenne ne fut pas aussi brillante que 20 ans avant pour l'examen du Brevet supérieur de Navigation, mais il faut être pragmatique : seul le résultat compte. J'ai d'ailleurs repris à ce moment l'entraînement en vol au mois de mai 1968. Quelques dix ans auparavant, lorsque la Compagnie nous avait fait passer des tests d'aptitude au pilotage (où j'avais été classé très bon !), j'avais fait quelques vols en solo sur une sorte de machine agricole baptisée NC 854. Rien ne s'était passé, aucune proposition n’avait eu lieu. Je l'avais regretté, car le changement de situation aurait été parfaitement acceptable, étant donné que j’avais à l’époque cinq ans seulement d’ancienneté à la Compagnie. Mais la situation n’avait pas évolué, grâce en grande partie à l’action des plus anciens d'entre nous qui voyaient d'un très mauvais œil un tel changement s’amorcer. J'avais donc abandonné la machine agricole NC 854, sans trop de regrets d’ailleurs !
Cette fois, je m'entraîne plus sérieusement en Safir et en Cessna. Et puis, intervient la signature du protocole Syndicat - Direction. Je suis assuré de travailler jusqu'à cinquante trois ans. Je me retrouve, comme je l'ai dit, à la tête des instructeurs. Ou je travaille encore une quinzaine d'années comme pilote - si je sors victorieusement du cours, mais... chat échaudé craint l’eau froide, ça n'est pas garanti ! - ou , arrivant « au top » de mon état de navigateur, je reste encore douze ans instructeur. Cruel dilemme ! Et j’ai préféré rester en place. L’avenir a prouvé que j’avais raison. De plus, en novembre 1969, on décide en haut lieu de (tenons nous bien) « me mettre en position de faisant fonction de Chef de Section » (Ouf ! ), mettant fin du même coup à mon statut d'instructeur, mais pour faire le même travail. On me promet d'examiner ma situation lors de la prochaine parution du nouveau règlement de l'Encadrement du Personnel Navigant Technique. Voilà qui change, sinon tout, du moins beaucoup de choses à ma situation et me conforte dans la décision que j'ai prise de rester navigateur. En juin suivant, je suis « confirmé dans ma fonction » de... faisant fonction. Que de subtilités ! Mais j'acquiers du même coup le statut de cadre, ce qui représente une certaine garantie pour l'avenir et une position plus confortable au sein de la Compagnie. Une période sans grand relief s’ensuit. Les vols, les cours, la préparation de ceux-ci, le planning des instructeurs de navigation, tout cela forme une routine intéressante certes, mais routine quand même.
En 1962, le Chef du Secteur navigateur doit prendre sa retraite. Un beau jour, il me convoque et, avec le Chef Navigateur de la Direction des Opérations, tous deux me proposent... leurs places, qui n'en feront plus qu'une. J'entretiens les meilleures relations avec l'un et l'autre, qui n'ont d'ailleurs pas peu contribué à faire de moi ce que je suis devenu. Le plus élevé hiérarchiquement, mon ami Castel, m'avait dissuadé de poser ma candidature au cours de pilotage, arguant qu'on ne commençait pas une carrière de pilote de ligne à quarante ans, ou alors on acceptait de se cantonner dans le rôle subalterne de copilote « à vie ». L'avenir lui donnera raison. Les « jeunes » navigateurs qui furent transformés en pilotes restèrent tous, sauf un, à la place droite et n’accédèrent pas au siège de gauche, celui du Commandant de Bord.
Enfin, dans ce cas, chacun a choisi son destin et Castel m’a bien aidé à le façonner. Avait-il une idée de derrière la tête à ce moment ? Je n'en ai rien soupçonné et quand ils me font tous deux cette proposition, je suis pris de court.
« Nous avons décidé de te proposer d’occuper notre place. Nous allons l'un et l’autre prendre notre retraite, il faut donc un successeur, et un seul, car l'effectif des navigateurs va diminuer jusqu’à disparaître dans douze ans. Nous ne pouvons confier la barre à un de tes anciens, ils sont tous bien trop conservateurs. Il faut quelqu’un qui sache s’adapter sans brader ce qui reste de la profession. Nous t'avons choisi parce que tu as été « bien élevé », car tu es comme nous, Officier de Marine de réserve et que, d'autre part, nous avons pu juger de la qualité de ton travail depuis que tu fais de la formation et de l'encadrement. Veux-tu le poste ? ».
Que répondre à cela, quand on ne s’y attend pas du tout ? Après quelques instants de réflexion intense, si on se sent capable de tenir le coup, on accepte. C'est du moins ce que je fais, sans avoir pu mesurer toutes les implications de ce changement de situation.